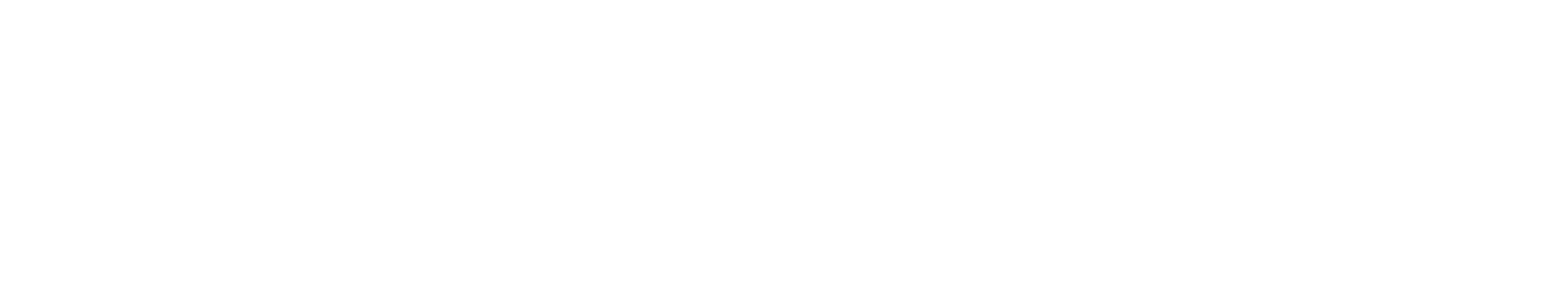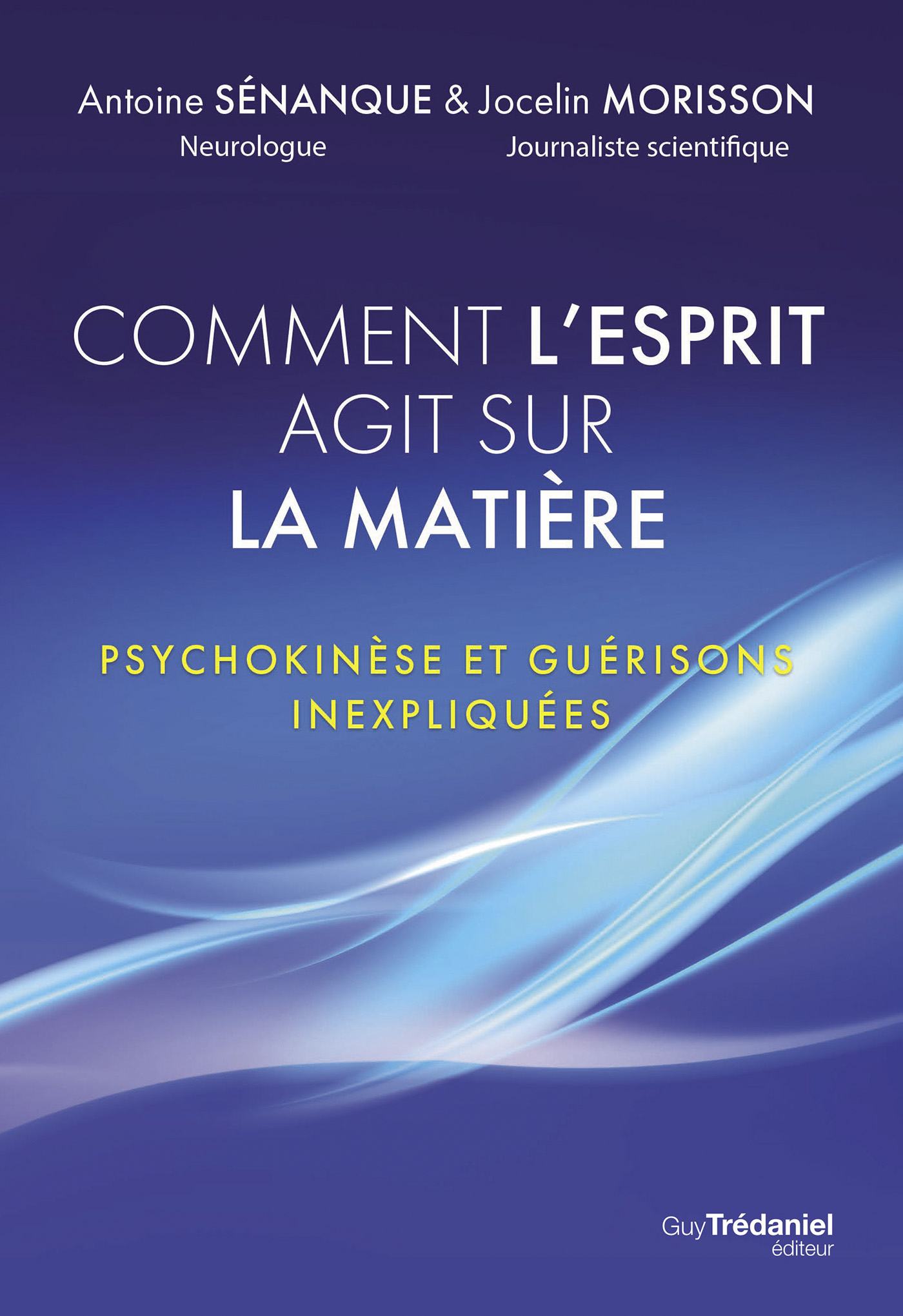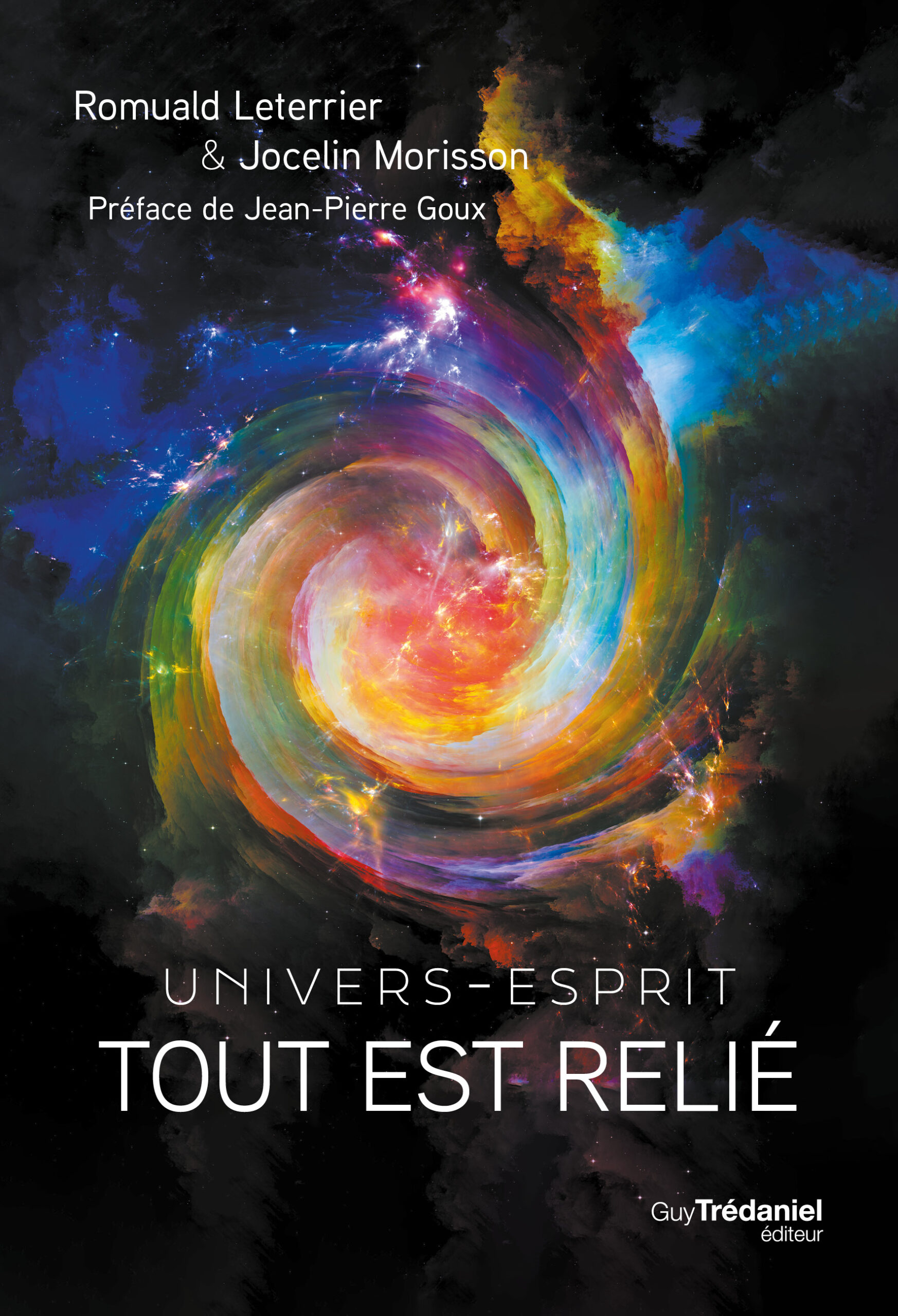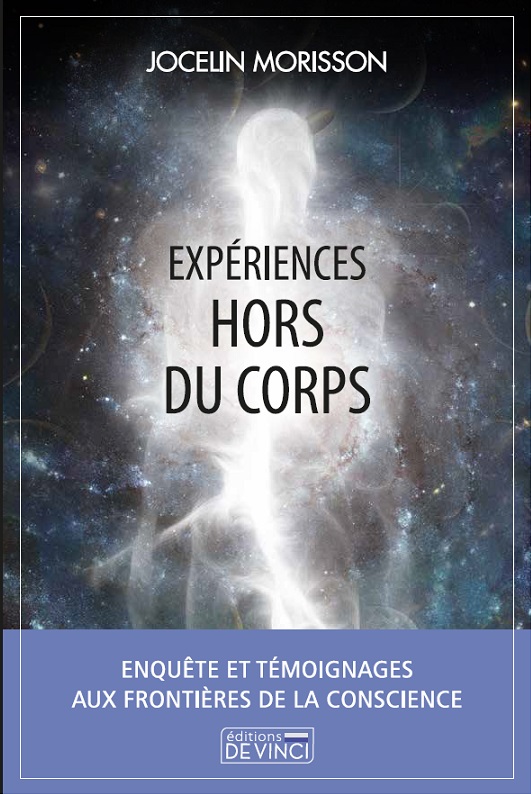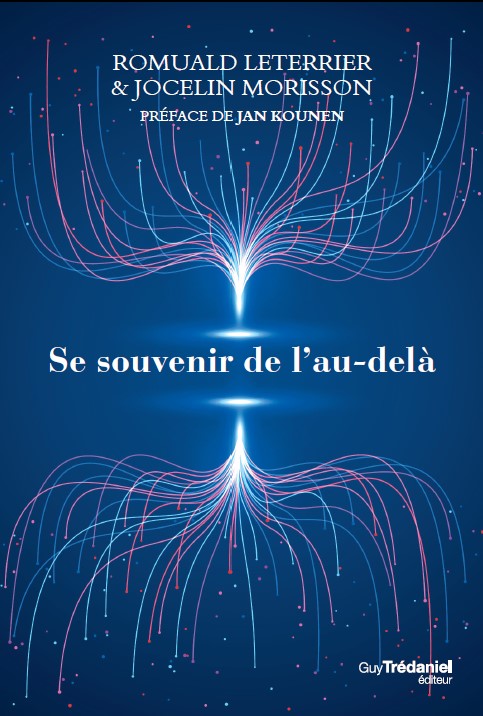Parmi les personnes qui s’intéressent à la spiritualité, beaucoup espèrent que la science va finir par démontrer la nature spirituelle de nos existences, attester que nous sommes une « âme » incarnée dans un corps matériel, prouver que la conscience perdure en l’absence d’activité cérébrale et qu’il existe une autre forme d’existence après la mort. Certains comptent même que la science prouvera l’existence de Dieu…

Dans le domaine des religions instituées, cette démarche qui vise à confirmer les enseignements religieux par la science s’appelle le concordisme. C’est une démarche dont il a été montré par beaucoup de philosophes/scientifiques qu’elle est vaine parce que la science et la religion procèdent de deux ordres de réalité (ou « magistères ») distincts. La science aurait à se prononcer sur la façon dont la nature fonctionne en mettant en évidence les lois qui sous-tendent ce fonctionnement, alors que la religion se prononcerait sur les « causes finales ». La science nous parlerait donc du « comment » alors que les religions nous diraient le « pourquoi ». Si l’on dépasse le cadre strictement religieux, qui repose sur un ensemble de doctrines, de dogmes et de « vérités révélées », il est parfaitement concevable que les progrès scientifiques amènent à décrire la nature humaine comme étant spirituelle, au sens où l’esprit (ou « la conscience ») serait la réalité première, fondamentale, d’où le monde matériel lui-même procède. A partir de l’étude de la conscience, et en particulier de ses « états modifiés », la science est tout près de démontrer que la conscience est capable d’exister sans son support physique matériel, c’est-à-dire indépendamment du cerveau, et qu’en tout cas elle n’y serait aucunement « localisée », ainsi que la conception dominante continue de le prétendre. Les recherches sur les vécus « hors du corps », dans un contexte de mort imminente ou lors de décorporations volontaires, pourraient aboutir très bientôt à prouver que la conscience est capable de percevoir une « cible » hors d’atteinte des sens physiques. Des données isolées sont d’ores et déjà recueillies et les chercheurs qui sont en leur possession attendent de pouvoir les présenter de façon irréfutable au plan scientifique, en respectant une méthodologie et le recours à des outils qui ne souffrent pas la contestation.
Qu’est-ce que la réalité ?
La physique quantique elle-même n’en finit pas de produire des résultats qui montrent sans ambiguïté que la réalité est non-locale, c’est-à-dire que des influences s’exercent entre particules ou systèmes quantiques indépendamment de l’espace et même du temps. Le consensus qui commence à émerger de ces recherches conduit à reconnaître que l’espace-temps n’est pas la réalité ultime, qu’il existe quelque chose au-delà ou « ailleurs ». Une autre conséquence plus spirituelle serait que la réalité forme un tout unique et indivisible, comme le disent toutes les traditions. Mais ces résultats amènent également à comprendre que ce qui est observé est pleinement dépendant de l’observateur lui-même. C’est la mort du fantasme d’objectivité. Il nous est impossible d’observer le réel tel qu’il est, « en soi » disent les philosophes, mais nous pouvons seulement « extraire de l’information » sur notre propre relation au réel. La logique à elle seule pousse à admettre relativement facilement que nous ne pouvons pas nous extraire de la réalité que nous observons pour tenter de la comprendre en quelque sorte « de l’extérieur ». Etant nous-mêmes immergés en elle, nous ne pouvons en « faire le tour » et devons nous contenter de la connaître « de l’intérieur ». Le magazine La Recherche, peu suspect d’accointances ou de sympathies ésotéristes, a titré à l’été 2014 : « La réalité n’existe pas », voulant dire en fait : la réalité n’existe pas indépendamment de notre observation et donc de notre relation à elle (un peu trop long pour un titre de Une). La nature ultime de l’espace et de la matière continue donc de nous échapper, mais le temps lui-même est présenté très sérieusement par des physiciens au-dessus de tout soupçon comme une probable illusion, due là encore à notre « immersion » dans l’espace-temps.
La physique quantique elle-même n’en finit pas de produire des résultats qui montrent sans ambiguïté que la réalité est non-locale, c’est-à-dire que des influences s’exercent entre particules ou systèmes quantiques indépendamment de l’espace et même du temps. Le consensus qui commence à émerger de ces recherches conduit à reconnaître que l’espace-temps n’est pas la réalité ultime, qu’il existe quelque chose au-delà ou « ailleurs ». Une autre conséquence plus spirituelle serait que la réalité forme un tout unique et indivisible, comme le disent toutes les traditions. Mais ces résultats amènent également à comprendre que ce qui est observé est pleinement dépendant de l’observateur lui-même. C’est la mort du fantasme d’objectivité. Il nous est impossible d’observer le réel tel qu’il est, « en soi » disent les philosophes, mais nous pouvons seulement « extraire de l’information » sur notre propre relation au réel. La logique à elle seule pousse à admettre relativement facilement que nous ne pouvons pas nous extraire de la réalité que nous observons pour tenter de la comprendre en quelque sorte « de l’extérieur ». Etant nous-mêmes immergés en elle, nous ne pouvons en « faire le tour » et devons nous contenter de la connaître « de l’intérieur ». Le magazine La Recherche, peu suspect d’accointances ou de sympathies ésotéristes, a titré à l’été 2014 : « La réalité n’existe pas », voulant dire en fait : la réalité n’existe pas indépendamment de notre observation et donc de notre relation à elle (un peu trop long pour un titre de Une). La nature ultime de l’espace et de la matière continue donc de nous échapper, mais le temps lui-même est présenté très sérieusement par des physiciens au-dessus de tout soupçon comme une probable illusion, due là encore à notre « immersion » dans l’espace-temps.
Qu’est-ce que la conscience ?
Il ne s’agit pas là des seules difficultés auxquelles la science fait face. Dans le domaine des neurosciences, la question de la conscience elle aussi reste une énigme pleine et entière. Pour le courant de pensée dominant, la façon dont la conscience « émergerait » de l’activité du cerveau est irrésolue. C’est ce que le philosophe David Chalmers a appelé le « problème difficile » de la conscience. Mais penser que la conscience émerge de l’activité cérébrale est en soi un biais considérable, car bien des données incitent à penser que le cerveau agirait bien plus probablement comme le filtre ou la valve de réduction d’un vaste champ de conscience afin de nous permettre de faire l’expérience de la réalité matérielle. Les vécus de « conscience étendue » de multiples natures, du voyage chamanique aux perceptions extrasensorielles, en sont des illustrations. L’épistémologue et physicien Michel Bitbol a lui aussi montré dans un ouvrage récent et magistral (La conscience a-t-elle une origine ?) que le problème de la conscience se heurte à un mur d’incomplétude. Pour comprendre la conscience, nous n’avons en effet qu’un seul outil qui est la conscience elle-même. Toute notre expérience du monde se rapporte en effet à la conscience et comment celle-ci pourrait-elle prétendre se saisir pleinement d’elle-même ? Dans la quête d’une compréhension complète de la conscience, un incontournable « point aveugle » se dresse sur la route. Seule une méta ou supra-conscience peut comprendre la conscience. A peine pouvons-nous comprendre la conscience « ordinaire » à partir de ses états extraordinaires : états modifiés de conscience, états de conscience minimale, locked-in syndrom, etc. mais quant à comprendre la totalité de ces états et obtenir une image globale de ce qu’est la conscience, nous en sommes très loin.
En amont, ou en-deçà, de la conscience réflexive, celle par laquelle nous pensons et savons que nous existons, se trouve la conscience primale, fondamentale, qui est simplement la conscience d’être, explique Michel Bitbol. De façon tout à fait intéressante, cette réflexion philosophique qui emprunte à la phénoménologie rejoint les conceptions orientales de la conscience, celles qui viennent de l’hindouisme, du bouddhisme et d’autres traditions spirituelles. On y parle de « conscience pure », de « claire lumière », d’états d’être sans forme ni pensée. Cette simple conscience d’être est également mise en avant par des enseignants contemporains tels qu’Eckart Tolle ou Jeff Foster qui nous appellent seulement à être présents, dans l’instant, sans jugement ni projection d’aucune sorte. Parvenir à vivre ainsi correspond à ce que les traditions nomment l’éveil.
Il ne s’agit pas là des seules difficultés auxquelles la science fait face. Dans le domaine des neurosciences, la question de la conscience elle aussi reste une énigme pleine et entière. Pour le courant de pensée dominant, la façon dont la conscience « émergerait » de l’activité du cerveau est irrésolue. C’est ce que le philosophe David Chalmers a appelé le « problème difficile » de la conscience. Mais penser que la conscience émerge de l’activité cérébrale est en soi un biais considérable, car bien des données incitent à penser que le cerveau agirait bien plus probablement comme le filtre ou la valve de réduction d’un vaste champ de conscience afin de nous permettre de faire l’expérience de la réalité matérielle. Les vécus de « conscience étendue » de multiples natures, du voyage chamanique aux perceptions extrasensorielles, en sont des illustrations. L’épistémologue et physicien Michel Bitbol a lui aussi montré dans un ouvrage récent et magistral (La conscience a-t-elle une origine ?) que le problème de la conscience se heurte à un mur d’incomplétude. Pour comprendre la conscience, nous n’avons en effet qu’un seul outil qui est la conscience elle-même. Toute notre expérience du monde se rapporte en effet à la conscience et comment celle-ci pourrait-elle prétendre se saisir pleinement d’elle-même ? Dans la quête d’une compréhension complète de la conscience, un incontournable « point aveugle » se dresse sur la route. Seule une méta ou supra-conscience peut comprendre la conscience. A peine pouvons-nous comprendre la conscience « ordinaire » à partir de ses états extraordinaires : états modifiés de conscience, états de conscience minimale, locked-in syndrom, etc. mais quant à comprendre la totalité de ces états et obtenir une image globale de ce qu’est la conscience, nous en sommes très loin.
En amont, ou en-deçà, de la conscience réflexive, celle par laquelle nous pensons et savons que nous existons, se trouve la conscience primale, fondamentale, qui est simplement la conscience d’être, explique Michel Bitbol. De façon tout à fait intéressante, cette réflexion philosophique qui emprunte à la phénoménologie rejoint les conceptions orientales de la conscience, celles qui viennent de l’hindouisme, du bouddhisme et d’autres traditions spirituelles. On y parle de « conscience pure », de « claire lumière », d’états d’être sans forme ni pensée. Cette simple conscience d’être est également mise en avant par des enseignants contemporains tels qu’Eckart Tolle ou Jeff Foster qui nous appellent seulement à être présents, dans l’instant, sans jugement ni projection d’aucune sorte. Parvenir à vivre ainsi correspond à ce que les traditions nomment l’éveil.
Ainsi, nous n’avons pas à attendre ni espérer que la science vienne confirmer qu’il existe des réalités au-delà du monde matériel, sensible, et que nous ne sommes pas des corps qui ont un esprit mais bien des esprits qui ont un corps. Selon ces enseignements, il suffit de le vivre car cet état de fait est la nature des choses que nous le voulions ou non. Vivre en plein accord avec cette réalité facilite cependant grandement l’existence car, en toute logique, il nous faut vivre en harmonie avec la nature, et avant toute notre propre nature humaine comme nous y enjoignaient les Stoïciens, pour tâcher d’être heureux et d’améliorer ainsi peu à peu l’état du monde autour de nous. « Etre le changement que nous voulons voir dans le monde », comme le suggérait également Gandhi, est non seulement la meilleure chose que nous puissions faire pour nous-mêmes et le monde, mais c’est aussi la seule. Cette proposition n’a jamais été autant d’actualité.