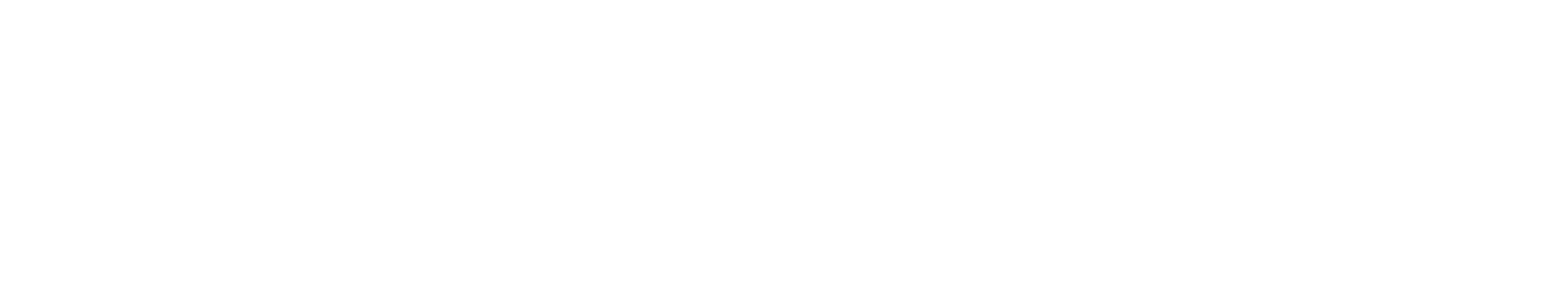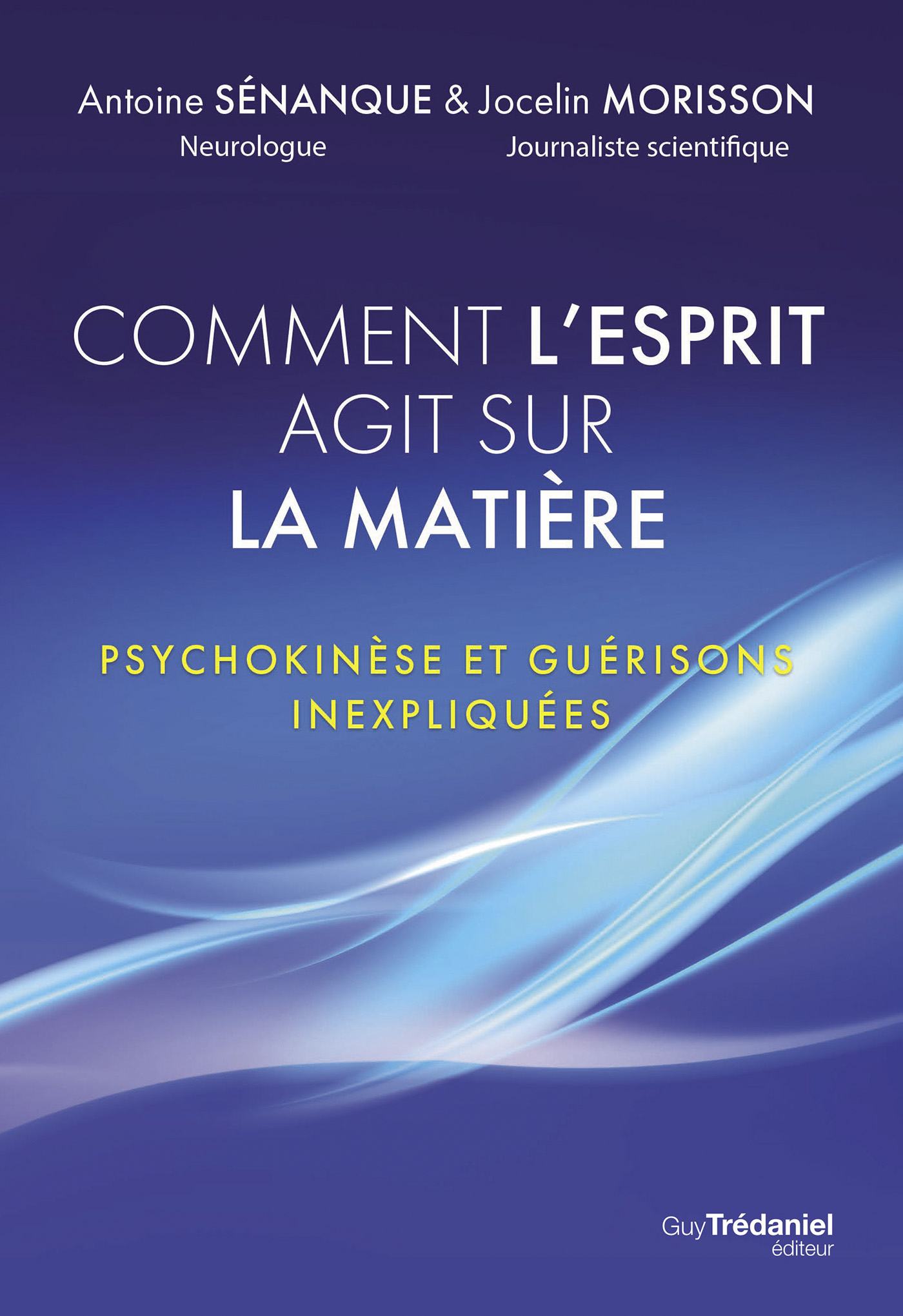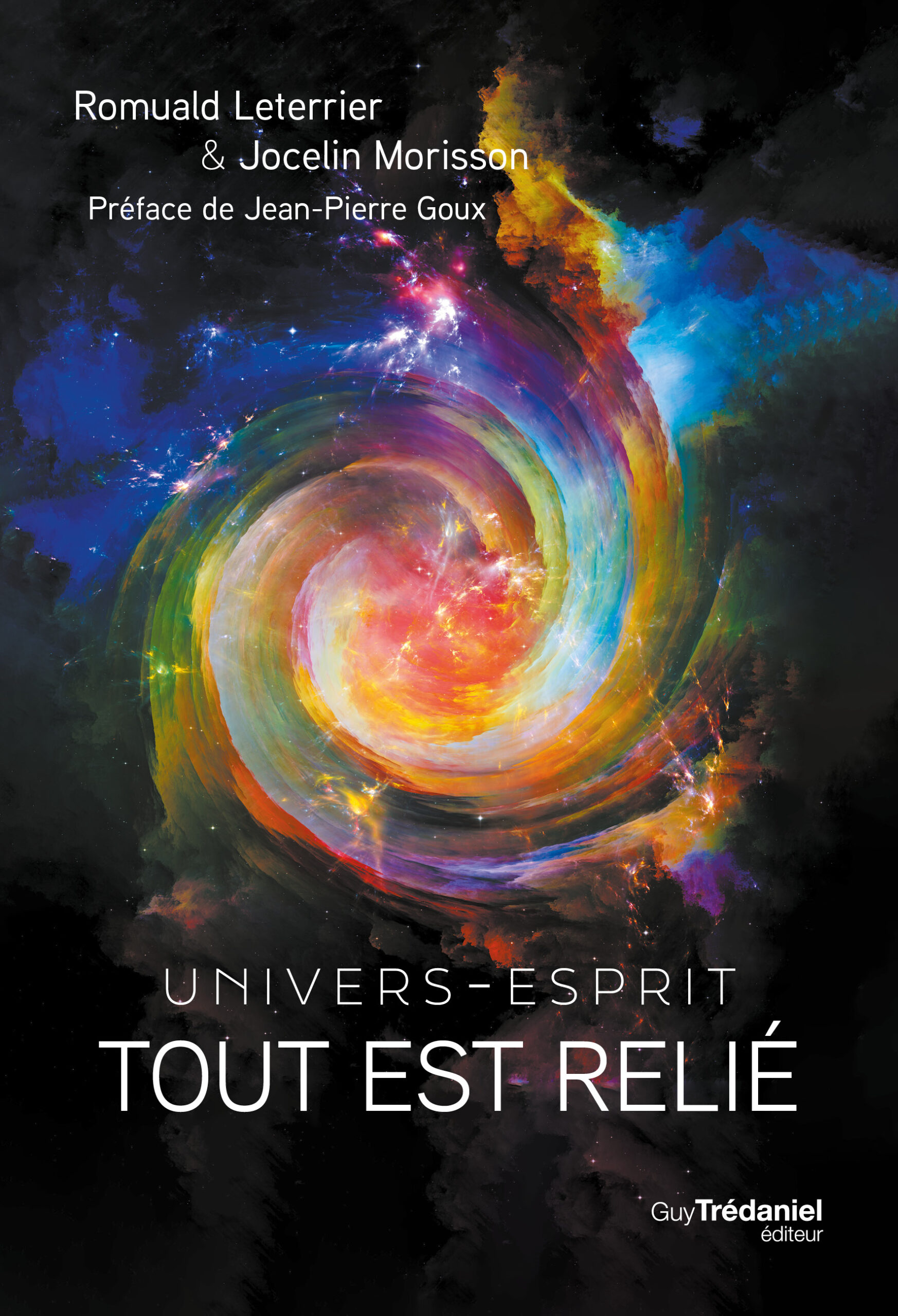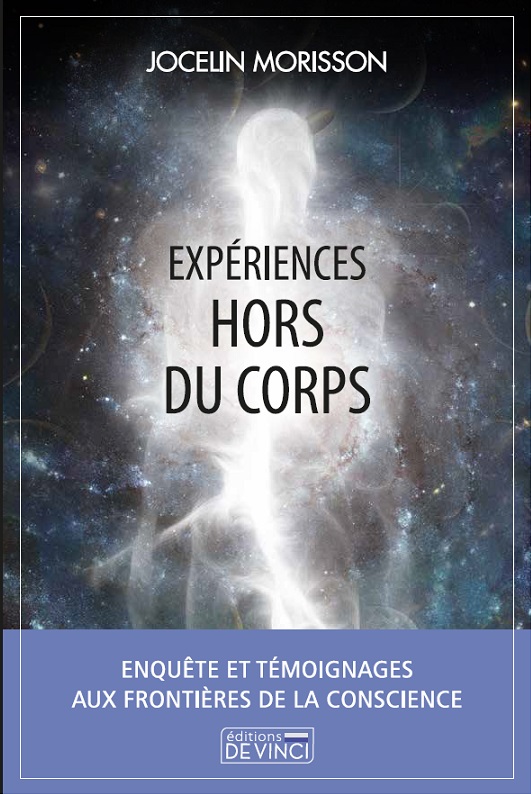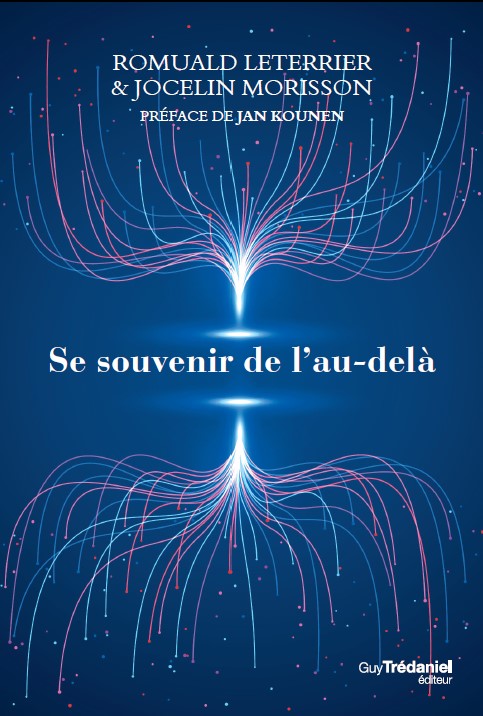La vie après la mort est une question qui fascine en privé mais qui dérange en public. Elle est du ressort de la foi, la religion, la spiritualité, ou encore de la philosophie et de la science. Mais c’est une question avant tout personnelle, et quand elle entre dans la sphère publique, celle de l’opinion et du débat, elle révèle des choses sur « l’état d’esprit » collectif d’une société. A cet égard, le traitement de l’étude scientifique AWARE (Awareness during resuscitation) par les medias au sens large est aussi intéressant que l’étude elle-même.
L’article scientifique a été publié dans une revue d’anesthésie-réanimation de langue anglaise, Resuscitation. Ce mot ne signifie pas « résurrection » mais « réanimation », ce qui n’a pas empêché plusieurs papiers de faire la confusion. Mais surtout, le communiqué de presse originel a été repris et commenté dans des directions diamétralement opposées. Quelques médias se sont ensuite donné la peine de consulter l’article scientifique du Dr Sam Parnia, qui a dirigé l’étude, mais là aussi des interprétations très libres des données et commentaires de l’étude ont été faites. Les premiers papiers ont donc annoncé en boucle qu’il y avait bien « une vie après la mort », ou « quelque chose après la mort », les plus prudents y mettant le conditionnel, sur le mode « soyez rassuré » ou « nous vous l’avions bien dit ». Cet enthousiasme a cependant vite été douché par une seconde salve d’articles ou reportages se voulant plus sérieux et affirmant qu’il ne s’agit pas de vie après la mort mais d’une activité du cerveau qui se poursuit quelque minutes après l’arrêt cardiaque. Cependant, ces deux interprétations sont fausses, si l’on se contente des données et commentaires de l’étude. En revanche, elles disent beaucoup de choses de la peur de l’époque. C’est comme si l’anxiété générée par des menaces mortifères comme le terrorisme islamique, le virus Ebola, la crise économique et financière, et y compris la bourse qui dégringole en ce moment, trouvait un soulagement dans l’idée que oui, il y a bien une vie après la mort. C’est quand la réalité dépasse l’affliction que la vie après la mort redevient crédible, en tout cas désirable, même là où la société est la plus sécularisée. Mais la réponse des médias « sceptiques » – qui nous rassurent sur un modèle du monde dans lequel « tout est sous contrôle » – est illustrée par le reportage du journal télévisé de France 2 (13/10/2014) qui affirme que l’activité du cerveau se poursuit plusieurs minutes après l’arrêt cardiaque, et donc il n’est pas question d’une preuve de la vie après la mort. Or, il s’agit là d’un grave contre-sens car l’étude prétend seulement qu’un « état de conscience » se poursuit, lequel n’est très probablement pas causé par une activité cérébrale, précisément parce que l’arrêt cardiaque interrompt le flux sanguin cérébral et que l’activité du cerveau, en surface comme en profondeur, cesse en vingt à trente secondes. En outre, Sam Parnia souligne qu’il est impropre de considérer la mort comme un « instant », alors qu’il s’agit plus d’un « processus » qui dépend des tentatives effectuées pour maintenir la vie. Ainsi, il est tout aussi abusif de prétendre que l’étude confirme d’une façon ou d’une autre la « vie après la mort », que d’avancer qu’une activité cérébrale se poursuit plusieurs minutes après un arrêt cardiaque. La question n’est pas « scientifiquement » tranchée et elle ne le sera jamais car il s’agit d’un problème philosophique, ce que très peu d’articles ont souligné, à l’exception notable de celui de Jean-Paul Fritz dans le Plus du Nouvel Observateur, paru parmi les premiers.
L’histoire de la cible qui repeint son plafond
Il est intéressant de se replonger dans la genèse de l’étude AWARE, car cette publication était très attendue par tous ceux qui s’intéressent à ce sujet, lequel n’est pas « morbide », contrairement à certaines réactions entendue à la radio, mais riche d’un sens éminemment important pour l’avenir de nos sociétés, justement. A l’origine, les chercheurs sont partis de l’hypothèse que les personnes faisant un arrêt cardiaque en service de réanimation seraient capables de voir la scène depuis un point de vue élevé et ainsi de percevoir une image qui serait fixée au plafond, décalée d’une dizaine de centimètres par rapport à ce plafond et donc visible seulement du dessus. La première étude pilote à l’hôpital de Southampton a dû être interrompue parce que la curiosité l’avait emportée chez certains soignants qui étaient allés regarder ce qui se trouvait sur ces dalles qui pendaient du plafond et étaient prétendument destinées à recueillir la poussière pour une étude sur l’hygiène à l’hôpital ! Pour que l’étude soit valide, il fallait en effet que personne ne sache quelle image se trouvait où, tout en les remplaçant régulièrement. Sam Parnia n’a pas abandonné pour autant et a lancé en 2008 une vaste étude regroupant une quinzaine d’hôpitaux en Europe et en Amérique du Nord pour recueillir les témoignages de personnes réanimées après un arrêt cardiaque. Dans les services concernés, des objets ou images « cibles » étaient disposées en hauteur selon différentes modalités mais toujours avec l’idée que ces cibles ne soient visibles que du dessus.
L’article présente les données issues de quatre années d’étude, mais celle-ci se poursuit dans les mêmes établissements. Au chapitre des résultats, on peut légitimement éprouver une certaine déception. Aucune cible n’a en effet été perçue par les patients recrutés dans l’étude, sur un échantillon initial de 2060 patients ayant connu un arrêt cardiaque, dont 330 ont été réanimés et 140 ont pu être interrogés une première fois puis 101 une seconde fois. Au sein de cet échantillon, l’article fait mention de 39 % de personnes qui rapportent des souvenirs d’un état de conscience plus ou moins précis de la période correspondant à l’arrêt cardiaque. Mais le contenu de ces souvenirs est beaucoup plus large que ce qui est traditionnellement associé à l’Expérience de Mort Imminente (EMI), et les thèmes mentionnés manquent de précision : sentiments de peur et de persécution, perception d’animaux et de plantes, perception d’une lumière brillante, famille, sentiments de déjà-vu. Un sous-ensemble de 9 % de patients rapporte cependant des souvenirs correspondant à une EMI, précise l’article, dont 2 % décrivent des perceptions compatibles avec la sortie du corps, à savoir le fait de voir et/ou d’entendre des événements liés à la réanimation. Un seul cas est mentionné comme relevant d’une perception d’éléments vérifiés a posteriori lors d’une période où le cerveau était supposé ne pas fonctionner. Ce cas validé comme « expérience hors du corps » repose notamment sur l’utilisation de stimuli auditifs pendant l’arrêt cardiaque, qui n’étaient autres que les bips émis par le défibrillateur. Des études précédentes ont en effet montré que l’électroencéphalogramme devient plat vingt à trente secondes après un arrêt cardiaque, c’est-à-dire que l’activité du cortex cérébral cesse. Or, les fonctions cognitives supérieures telles que la vision ou l’audition et la mémoire sont associées au fonctionnement du cortex. Le cas retenu répond donc à toutes les exigences de rigueur permettant d’affirmer que le patient n’était pas capable de perceptions ni de mémorisation. L’article scientifique donne pourtant des détails de son témoignage. Il s’agit d’un travailleur social de Southampton âgé de 57 ans. Dans un premier temps, celui-ci décrit ses souvenirs conscients, avant l’arrêt cardiaque. Puis survient ce qu’il décrit comme un black-out, une perte de conscience. « Pourtant, je me souviens très bien d’une voix automatisée disant « choquez le patient, choquez le patient », et que, dans [le] coin de la salle il y avait une [femme] qui me faisait signe. Je me rappelle avoir pensé en moi-même « je ne peux pas aller là-bas »… Elle me fait signe… Je sentais qu’elle me connaissait, je sentais que je pouvais lui faire confiance, et je sentais qu’elle était là pour une raison, et je ne savais pas ce que c’était. La seconde suivante, j’étais là, me regardant « d’en haut ». Il y avait l’infirmière, et un autre homme qui avait une tête chauve. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je pouvais voir l’arrière de son corps. C’était un gars trapu… Il avait des habits bleus, et un chapeau bleu, mais je peux dire qu’il était chauve, du fait de l’endroit où était positionné son chapeau. » Le patient s’est alors réveillé. Il explique avoir reçu le lendemain la visite d’un médecin qu’il a identifié comme « l’homme chauve ». Au cours d’un second entretien, il précise : « Au début, je pense, j’ai entendu l’infirmière dire « composer le 444, arrêt cardiaque ». (…) J’étais au plafond, et regardais vers le bas. (…) J’ai vu ma tension artérielle prise alors que le médecin mettait quelque chose dans ma gorge. J’ai vu une infirmière [appuyer sur mon sternum]. J’ai vu que l’on prenait [mon taux de glucose]. »
Il est intéressant de se replonger dans la genèse de l’étude AWARE, car cette publication était très attendue par tous ceux qui s’intéressent à ce sujet, lequel n’est pas « morbide », contrairement à certaines réactions entendue à la radio, mais riche d’un sens éminemment important pour l’avenir de nos sociétés, justement. A l’origine, les chercheurs sont partis de l’hypothèse que les personnes faisant un arrêt cardiaque en service de réanimation seraient capables de voir la scène depuis un point de vue élevé et ainsi de percevoir une image qui serait fixée au plafond, décalée d’une dizaine de centimètres par rapport à ce plafond et donc visible seulement du dessus. La première étude pilote à l’hôpital de Southampton a dû être interrompue parce que la curiosité l’avait emportée chez certains soignants qui étaient allés regarder ce qui se trouvait sur ces dalles qui pendaient du plafond et étaient prétendument destinées à recueillir la poussière pour une étude sur l’hygiène à l’hôpital ! Pour que l’étude soit valide, il fallait en effet que personne ne sache quelle image se trouvait où, tout en les remplaçant régulièrement. Sam Parnia n’a pas abandonné pour autant et a lancé en 2008 une vaste étude regroupant une quinzaine d’hôpitaux en Europe et en Amérique du Nord pour recueillir les témoignages de personnes réanimées après un arrêt cardiaque. Dans les services concernés, des objets ou images « cibles » étaient disposées en hauteur selon différentes modalités mais toujours avec l’idée que ces cibles ne soient visibles que du dessus.
L’article présente les données issues de quatre années d’étude, mais celle-ci se poursuit dans les mêmes établissements. Au chapitre des résultats, on peut légitimement éprouver une certaine déception. Aucune cible n’a en effet été perçue par les patients recrutés dans l’étude, sur un échantillon initial de 2060 patients ayant connu un arrêt cardiaque, dont 330 ont été réanimés et 140 ont pu être interrogés une première fois puis 101 une seconde fois. Au sein de cet échantillon, l’article fait mention de 39 % de personnes qui rapportent des souvenirs d’un état de conscience plus ou moins précis de la période correspondant à l’arrêt cardiaque. Mais le contenu de ces souvenirs est beaucoup plus large que ce qui est traditionnellement associé à l’Expérience de Mort Imminente (EMI), et les thèmes mentionnés manquent de précision : sentiments de peur et de persécution, perception d’animaux et de plantes, perception d’une lumière brillante, famille, sentiments de déjà-vu. Un sous-ensemble de 9 % de patients rapporte cependant des souvenirs correspondant à une EMI, précise l’article, dont 2 % décrivent des perceptions compatibles avec la sortie du corps, à savoir le fait de voir et/ou d’entendre des événements liés à la réanimation. Un seul cas est mentionné comme relevant d’une perception d’éléments vérifiés a posteriori lors d’une période où le cerveau était supposé ne pas fonctionner. Ce cas validé comme « expérience hors du corps » repose notamment sur l’utilisation de stimuli auditifs pendant l’arrêt cardiaque, qui n’étaient autres que les bips émis par le défibrillateur. Des études précédentes ont en effet montré que l’électroencéphalogramme devient plat vingt à trente secondes après un arrêt cardiaque, c’est-à-dire que l’activité du cortex cérébral cesse. Or, les fonctions cognitives supérieures telles que la vision ou l’audition et la mémoire sont associées au fonctionnement du cortex. Le cas retenu répond donc à toutes les exigences de rigueur permettant d’affirmer que le patient n’était pas capable de perceptions ni de mémorisation. L’article scientifique donne pourtant des détails de son témoignage. Il s’agit d’un travailleur social de Southampton âgé de 57 ans. Dans un premier temps, celui-ci décrit ses souvenirs conscients, avant l’arrêt cardiaque. Puis survient ce qu’il décrit comme un black-out, une perte de conscience. « Pourtant, je me souviens très bien d’une voix automatisée disant « choquez le patient, choquez le patient », et que, dans [le] coin de la salle il y avait une [femme] qui me faisait signe. Je me rappelle avoir pensé en moi-même « je ne peux pas aller là-bas »… Elle me fait signe… Je sentais qu’elle me connaissait, je sentais que je pouvais lui faire confiance, et je sentais qu’elle était là pour une raison, et je ne savais pas ce que c’était. La seconde suivante, j’étais là, me regardant « d’en haut ». Il y avait l’infirmière, et un autre homme qui avait une tête chauve. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je pouvais voir l’arrière de son corps. C’était un gars trapu… Il avait des habits bleus, et un chapeau bleu, mais je peux dire qu’il était chauve, du fait de l’endroit où était positionné son chapeau. » Le patient s’est alors réveillé. Il explique avoir reçu le lendemain la visite d’un médecin qu’il a identifié comme « l’homme chauve ». Au cours d’un second entretien, il précise : « Au début, je pense, j’ai entendu l’infirmière dire « composer le 444, arrêt cardiaque ». (…) J’étais au plafond, et regardais vers le bas. (…) J’ai vu ma tension artérielle prise alors que le médecin mettait quelque chose dans ma gorge. J’ai vu une infirmière [appuyer sur mon sternum]. J’ai vu que l’on prenait [mon taux de glucose]. »
Un cas en béton ?
Les auteurs de l’article soulignent l’intérêt de ce témoignage. En effet, le rapport médical « confirme l’utilisation d’une réanimation par défibrillateur, la présence de l’équipe médicale autour du patient au moment de son arrêt cardiaque, et le rôle de l’homme en bleu ». Ils notent que les protocoles de réanimation imposent un intervalle d’au moins deux minutes entre chaque utilisation du défibrillateur, de sorte que la conscience du patient a dû perdurer – après son arrêt cardiaque – durant environ trois minutes. Malheureusement, aucune cible visuelle ne se trouvait dans cette pièce dans le cadre de l’étude. Pourtant, « cela est significatif, a expliqué Sam Parnia, car il a souvent été dit que ces expériences en lien avec la mort sont probablement des hallucinations ou des illusions, qui se produisent soit avant que le cœur ne s’arrête, soit après qu’on l’ait fait repartir, mais ne constituent pas une expérience correspondant à des événements réels survenant au moment où le cœur ne bat plus. Dans ce cas, la conscience et l’attention ont été possibles pendant la période de trois minutes au cours de laquelle le cœur ne battait plus. Ceci est paradoxal car le cerveau cesse de fonctionner dans les 20 à 30 secondes qui suivent l’arrêt cardiaque et ne recommence à fonctionner qu’une fois le cœur reparti. De plus, les souvenirs détaillés de conscience visuelle dans le cas rapporté sont cohérents avec les événements vérifiés. » Il s’agit là de commentaires rapportés dans des articles de presse, mais il faut s’intéresser également aux mots choisis dans l’article scientifique original, qui visent à interpeller l’ensemble de la communauté scientifique : « Ainsi, dans le cadre d’un modèle qui suppose une relation causale entre l’activité corticale et la conscience, la survenue d’un processus mental et la capacité à décrire des événements au cours de l’arrêt cardiaque, telle qu’elle a été possible dans ce cas vérifié de conscience visuelle alors que la fonction cérébrale est absente ou au mieux sévèrement endommagée, est intrigante (perplexing). Ceci est d’autant plus le cas que la réduction du flux sanguin cérébral conduit typiquement à un délire suivi par un coma, plutôt qu’à un état mental lucide. »
Dans les situations d’arrêt cardiaque, l’interruption du flux sanguin au cerveau conduit en quelques dizaines de secondes à un EEG isoélectrique, c’est-à-dire plat. Mais l’électroencéphalogramme ne traduit que l’activité de la couche externe du cerveau, le cortex. Même si celui-ci permet les fonctions cognitives supérieures comme la pensée, la mémoire et le sens de l’identité, ne peut-on imaginer que des structures plus profondes du cerveau soient à l’œuvre pendant quelques minutes et « produisent » une telle expérience ? Selon Sam Parnia, cela reste improbable parce que le flux sanguin interrompu en cas d’arrêt cardiaque concerne l’ensemble du cerveau et non certaines zones spécifiques, comme cela est montré par la perte des réflexes qui traduit l’absence d’activité du tronc cérébral, à la base du cerveau. Des études chez l’animal ont montré que les structures plus profondes du cerveau n’avaient pas non plus d’activité très rapidement après l’arrêt cardiaque, même si une étude en particulier a fait mention d’un « rush » au cours des trente secondes qui suivent l’arrêt cardiaque chez le rat. Cette observation n’a pas été confirmée chez l’homme mais la période correspond de toute façon à celle ou le cerveau se vide de son sang, alors que dans les témoignages d’EMI plusieurs situations sont bien postérieures à ces quelques dizaines de secondes qui suivent l’arrêt cardiaque. Dans son étude, Sam Parnia précise également que l’absence d’activité cérébrale se poursuit même pendant la réanimation parce que les gestes de réanimation cardiorespiratoire ne suffisent pas à produire un flux sanguin assez intense pour remettre le cerveau en service au plan métabolique. Ces gestes permettent en effet d’éviter que les structures cérébrales ne soient complètement privées de sang pendant une trop longue période, mais sont insuffisants pour faire reprendre conscience au sujet. Cette reprise de conscience ne survient qu’après que le cœur soit reparti sur un rythme normal. « De plus, ajoute Sam Parnia, dans la mesure où les hallucinations se réfèrent à des expériences qui ne correspondent pas à la réalité objective, nos observations ne suggèrent pas que la conscience visuelle lors de l’arrêt cardiaque soit de nature hallucinatoire ou illusoire puisque les souvenirs correspondaient à des événements authentiques vérifiés. »
Les auteurs de l’article soulignent l’intérêt de ce témoignage. En effet, le rapport médical « confirme l’utilisation d’une réanimation par défibrillateur, la présence de l’équipe médicale autour du patient au moment de son arrêt cardiaque, et le rôle de l’homme en bleu ». Ils notent que les protocoles de réanimation imposent un intervalle d’au moins deux minutes entre chaque utilisation du défibrillateur, de sorte que la conscience du patient a dû perdurer – après son arrêt cardiaque – durant environ trois minutes. Malheureusement, aucune cible visuelle ne se trouvait dans cette pièce dans le cadre de l’étude. Pourtant, « cela est significatif, a expliqué Sam Parnia, car il a souvent été dit que ces expériences en lien avec la mort sont probablement des hallucinations ou des illusions, qui se produisent soit avant que le cœur ne s’arrête, soit après qu’on l’ait fait repartir, mais ne constituent pas une expérience correspondant à des événements réels survenant au moment où le cœur ne bat plus. Dans ce cas, la conscience et l’attention ont été possibles pendant la période de trois minutes au cours de laquelle le cœur ne battait plus. Ceci est paradoxal car le cerveau cesse de fonctionner dans les 20 à 30 secondes qui suivent l’arrêt cardiaque et ne recommence à fonctionner qu’une fois le cœur reparti. De plus, les souvenirs détaillés de conscience visuelle dans le cas rapporté sont cohérents avec les événements vérifiés. » Il s’agit là de commentaires rapportés dans des articles de presse, mais il faut s’intéresser également aux mots choisis dans l’article scientifique original, qui visent à interpeller l’ensemble de la communauté scientifique : « Ainsi, dans le cadre d’un modèle qui suppose une relation causale entre l’activité corticale et la conscience, la survenue d’un processus mental et la capacité à décrire des événements au cours de l’arrêt cardiaque, telle qu’elle a été possible dans ce cas vérifié de conscience visuelle alors que la fonction cérébrale est absente ou au mieux sévèrement endommagée, est intrigante (perplexing). Ceci est d’autant plus le cas que la réduction du flux sanguin cérébral conduit typiquement à un délire suivi par un coma, plutôt qu’à un état mental lucide. »
Dans les situations d’arrêt cardiaque, l’interruption du flux sanguin au cerveau conduit en quelques dizaines de secondes à un EEG isoélectrique, c’est-à-dire plat. Mais l’électroencéphalogramme ne traduit que l’activité de la couche externe du cerveau, le cortex. Même si celui-ci permet les fonctions cognitives supérieures comme la pensée, la mémoire et le sens de l’identité, ne peut-on imaginer que des structures plus profondes du cerveau soient à l’œuvre pendant quelques minutes et « produisent » une telle expérience ? Selon Sam Parnia, cela reste improbable parce que le flux sanguin interrompu en cas d’arrêt cardiaque concerne l’ensemble du cerveau et non certaines zones spécifiques, comme cela est montré par la perte des réflexes qui traduit l’absence d’activité du tronc cérébral, à la base du cerveau. Des études chez l’animal ont montré que les structures plus profondes du cerveau n’avaient pas non plus d’activité très rapidement après l’arrêt cardiaque, même si une étude en particulier a fait mention d’un « rush » au cours des trente secondes qui suivent l’arrêt cardiaque chez le rat. Cette observation n’a pas été confirmée chez l’homme mais la période correspond de toute façon à celle ou le cerveau se vide de son sang, alors que dans les témoignages d’EMI plusieurs situations sont bien postérieures à ces quelques dizaines de secondes qui suivent l’arrêt cardiaque. Dans son étude, Sam Parnia précise également que l’absence d’activité cérébrale se poursuit même pendant la réanimation parce que les gestes de réanimation cardiorespiratoire ne suffisent pas à produire un flux sanguin assez intense pour remettre le cerveau en service au plan métabolique. Ces gestes permettent en effet d’éviter que les structures cérébrales ne soient complètement privées de sang pendant une trop longue période, mais sont insuffisants pour faire reprendre conscience au sujet. Cette reprise de conscience ne survient qu’après que le cœur soit reparti sur un rythme normal. « De plus, ajoute Sam Parnia, dans la mesure où les hallucinations se réfèrent à des expériences qui ne correspondent pas à la réalité objective, nos observations ne suggèrent pas que la conscience visuelle lors de l’arrêt cardiaque soit de nature hallucinatoire ou illusoire puisque les souvenirs correspondaient à des événements authentiques vérifiés. »
Une réflexion élargie
Commentant le pourcentage de 39 % de patients qui rapportent une forme ou une autre de souvenirs, Sam Parnia ajoute que « cela suggère que davantage de personnes peuvent avoir une activité mentale dans ces circonstances mais perdent ensuite ces souvenirs après leur guérison, soit à cause de dommages cérébraux ou de l’effet des médicaments sur la formation de souvenirs. » Les commentaires généraux de Sam Parnia montrent qu’il cherche, sans doute légitimement, à sortir l’EMI d’un certain ghetto qui l’associe aux phénomènes dits paranormaux. Selon lui l’utilisation de termes comme « mort imminente » ou « hors du corps » n’est pas assez précise et ne rend pas suffisamment compte de l’étendue des souvenirs associés à la période de l’arrêt cardiaque, qui est « biologiquement synonyme de mort », précise-t-il. Mais surtout, il milite depuis des années pour que l’on cesse de parler de la mort comme d’un « instant ». « Contrairement à ce que l’on croit le plus souvent, la mort n’est pas un moment spécifique, souligne Sam Parnia, mais un processus potentiellement réversible qui survient lorsque toute maladie grave ou accident entraîne la cessation de fonctionnement du cœur, des poumons et du cerveau. Si des tentatives sont effectuées pour inverser ce processus, il est synonyme d’arrêt cardiaque. Cependant, si ces tentatives sont vaines, ce processus est équivalent à la mort. Dans cette étude, nous avons voulu aller au-delà de la formule émotionnellement chargée et cependant mal définie d’expérience de mort imminente pour explorer objectivement ce qui se passe lorsque nous mourrons. » La réflexion se poursuit mais on voit combien Sam Parnia est à la fois précautionneux et volontariste, car il tente de rendre acceptable par la communauté scientifique des idées qui continuent à déranger. Si la science venait à démontrer, comme elle le suggère seulement actuellement, que l’existence se poursuit après la mort, certains y verraient un échec de l’entreprise des Lumières, qui visait à se défaire des dogmes de la foi. Pourtant la science n’a qu’un seul objet qui est le réel, dans tous ses aspects, toutes ses dimensions, éventuellement même au-delà du sensible, et elle ne doit donc rien s’interdire.
Car avant même la question de la vie après la mort, ces expériences interrogent sur la nature de la conscience, et les EMI ne sont pas les seuls phénomènes à prendre en compte « en la matière ». Un collectif de scientifiques de haut vol vient de publier un manifeste pour une « science post-matérialiste », à l’initiative du neuropsychologue québécois Mario Beauregard. On retrouve dans l’aréopage le neuropsychiatre Gary Schwartz ou le biologiste Rupert Sheldrake et le texte dénonce : « La domination quasi absolue du matérialisme dans le milieu académique a étouffé les sciences et entravé le développement de l’étude scientifique de l’esprit et de la spiritualité. La foi en cette idéologie, comme cadre explicatif exclusif de la réalité, a amené les scientifiques à négliger la dimension subjective de l’expérience humaine. Cela a conduit à une conception fortement déformée et appauvrie de nous-mêmes et de notre place dans la nature. » Ainsi, selon le paradigme post-matérialiste, « l’esprit représente un aspect de la réalité tout aussi primordial que le monde physique. L’esprit joue un rôle fondamental dans l’univers, il ne peut être dérivé de la matière et réduit à quelque chose de plus basique. »
Un texte qu’aurait pu signer Sam Parnia, selon qui « la réalité de l’expérience humaine n’est pas déterminée neurologiquement », mais « à travers un processus social dans lequel les êtres humains déterminent et attribuent du sens à un phénomène ou une expérience. » Ainsi, conclut-il, « bien que des modifications au niveau de neurotransmetteurs spécifiques impliquées dans les expériences de la « réalité » quotidienne peuvent également conduire à des illusions ou des hallucinations, cela ne prouve ni ne contredit la réalité de n’importe quelle expérience, qu’il s’agisse de l’amour, des EMI ou d’autre chose. »
Commentant le pourcentage de 39 % de patients qui rapportent une forme ou une autre de souvenirs, Sam Parnia ajoute que « cela suggère que davantage de personnes peuvent avoir une activité mentale dans ces circonstances mais perdent ensuite ces souvenirs après leur guérison, soit à cause de dommages cérébraux ou de l’effet des médicaments sur la formation de souvenirs. » Les commentaires généraux de Sam Parnia montrent qu’il cherche, sans doute légitimement, à sortir l’EMI d’un certain ghetto qui l’associe aux phénomènes dits paranormaux. Selon lui l’utilisation de termes comme « mort imminente » ou « hors du corps » n’est pas assez précise et ne rend pas suffisamment compte de l’étendue des souvenirs associés à la période de l’arrêt cardiaque, qui est « biologiquement synonyme de mort », précise-t-il. Mais surtout, il milite depuis des années pour que l’on cesse de parler de la mort comme d’un « instant ». « Contrairement à ce que l’on croit le plus souvent, la mort n’est pas un moment spécifique, souligne Sam Parnia, mais un processus potentiellement réversible qui survient lorsque toute maladie grave ou accident entraîne la cessation de fonctionnement du cœur, des poumons et du cerveau. Si des tentatives sont effectuées pour inverser ce processus, il est synonyme d’arrêt cardiaque. Cependant, si ces tentatives sont vaines, ce processus est équivalent à la mort. Dans cette étude, nous avons voulu aller au-delà de la formule émotionnellement chargée et cependant mal définie d’expérience de mort imminente pour explorer objectivement ce qui se passe lorsque nous mourrons. » La réflexion se poursuit mais on voit combien Sam Parnia est à la fois précautionneux et volontariste, car il tente de rendre acceptable par la communauté scientifique des idées qui continuent à déranger. Si la science venait à démontrer, comme elle le suggère seulement actuellement, que l’existence se poursuit après la mort, certains y verraient un échec de l’entreprise des Lumières, qui visait à se défaire des dogmes de la foi. Pourtant la science n’a qu’un seul objet qui est le réel, dans tous ses aspects, toutes ses dimensions, éventuellement même au-delà du sensible, et elle ne doit donc rien s’interdire.
Car avant même la question de la vie après la mort, ces expériences interrogent sur la nature de la conscience, et les EMI ne sont pas les seuls phénomènes à prendre en compte « en la matière ». Un collectif de scientifiques de haut vol vient de publier un manifeste pour une « science post-matérialiste », à l’initiative du neuropsychologue québécois Mario Beauregard. On retrouve dans l’aréopage le neuropsychiatre Gary Schwartz ou le biologiste Rupert Sheldrake et le texte dénonce : « La domination quasi absolue du matérialisme dans le milieu académique a étouffé les sciences et entravé le développement de l’étude scientifique de l’esprit et de la spiritualité. La foi en cette idéologie, comme cadre explicatif exclusif de la réalité, a amené les scientifiques à négliger la dimension subjective de l’expérience humaine. Cela a conduit à une conception fortement déformée et appauvrie de nous-mêmes et de notre place dans la nature. » Ainsi, selon le paradigme post-matérialiste, « l’esprit représente un aspect de la réalité tout aussi primordial que le monde physique. L’esprit joue un rôle fondamental dans l’univers, il ne peut être dérivé de la matière et réduit à quelque chose de plus basique. »
Un texte qu’aurait pu signer Sam Parnia, selon qui « la réalité de l’expérience humaine n’est pas déterminée neurologiquement », mais « à travers un processus social dans lequel les êtres humains déterminent et attribuent du sens à un phénomène ou une expérience. » Ainsi, conclut-il, « bien que des modifications au niveau de neurotransmetteurs spécifiques impliquées dans les expériences de la « réalité » quotidienne peuvent également conduire à des illusions ou des hallucinations, cela ne prouve ni ne contredit la réalité de n’importe quelle expérience, qu’il s’agisse de l’amour, des EMI ou d’autre chose. »
Pour aller plus loin:
L’Expérience de mort imminente – une enquête aux frontières de l’après-vie
Jocelin Morisson – Editions de La Martinière, 2015
L’Expérience de mort imminente – une enquête aux frontières de l’après-vie
Jocelin Morisson – Editions de La Martinière, 2015